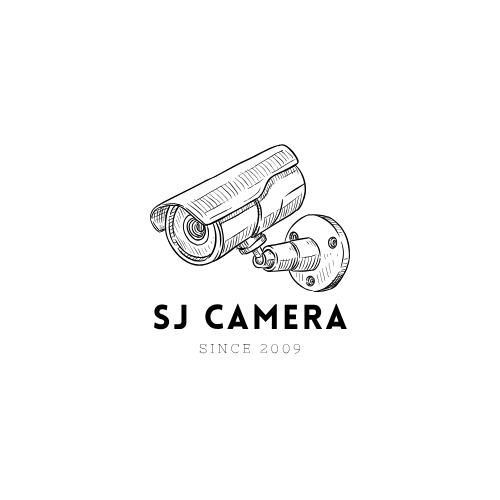Serena Carone : Sculptrice des songes et faiseuse de mythes contemporains #
La genèse d’un imaginaire : l’autodidacte et son atelier #
Le parcours de Serena Carone échappe aux trajectoires linéaires. Autodidacte confirmée, elle débute par la confection d’objets en cire, acier puis en papier dans les années 1980. Rapidement, la faïence et la céramique s’imposent, offrant à cette créatrice parisienne un terrain unique pour conjuguer imagination et savoir-faire manuel.
Installée dans un atelier insoupçonné, entre Ménilmontant et les abords de la Butte-aux-Cailles à Paris, elle cultive un espace où s’accumulent les grandes dormeuses de faïence et les pieuvres monumentales, témoins d’une production qui s’apparente à une recherche alchimique du vivant.
- Expérimentation de matériaux : passage de la cire à la faïence, évolution vers un raffinement technique mêlé d’intuition.
- Création dans des espaces modestes : chaque sculpture prend forme dans un rapport intime avec le lieu et la lumière, renforçant sa dimension introspective.
- Dialogue constant avec la matière : l’environnement foisonnant stimule une narration visuelle en mutation permanente.
Ce contexte d’atelier, peuplé de créatures énigmatiques, devient le théâtre d’une alchimie singulière, où l’émergence des formes échappe à la routine et cherche continuellement l’émerveillement, la surprise.
Notre impression est que cette immersion dans un monde de volumes puissants, de textures raffinées, forge un rapport sans filtre à l’œuvre, l’artiste posant chaque pièce comme un jalon d’une histoire personnelle qui s’écrit hors des codes institutionnels.
Une matière vivante, façonnée et ritualisée #
L’expérimentation des matériaux caractérise de manière frappante la démarche de Serena Carone. Choisissant la faïence et la céramique pour leur plasticité expressive et leur capacité à traduire l’organique, elle privilégie un travail artisanal mené dans des fours modestes, loin des procédés industriels.
Ce sont ces choix techniques qui permettent d’obtenir des pièces d’une fragilité assumée mais à la présence saisissante. Le modelage précis, mêlé de jeux de textures — lisse, rugueux, granuleux ou émaillé — compose des surfaces où la lumière accroche chaque aspérité, chaque détail symbolique. L’assemblage de matières hétérogènes, allié à une palette chromatique souvent sourde mais ponctuée d’éclats, donne à chaque œuvre une dimension mythologique remarquable.
À lire L’évolution de la photographie : de 1839 à l’IA en 2026
- Céramique : technique dominante dans la pratique de l’artiste après 2000, avec une maîtrise des émaux et surfaces éclatantes.
- Faïence : privilégiée pour la création d’animaux marins et de bestiaires symboliques, notamment pour ses pieuvres et ours.
- Technique de cuisson traditionnelle, adossée à un savoir-faire autodidacte, confère à chaque pièce une authenticité palpable.
- Rituels de création : la sculpture se construit dans une méditation tactile, chaque étape du façonnage étant conçue comme une séquence rituelle, presque sacrée.
Nous sommes frappés par cette alliance de rigueur artisanale et d’intuition poétique, génératrice d’une force dramaturgique discrète mais constante. Voilà pourquoi l’œuvre de Serena Carone s’impose comme un contre-point visuel, en tension entre naturalisme et invention pure, jouant d’une ambiguïté plastique qui suscite l’envie d’y revenir.
Bestiaire et figures énigmatiques : une narration visuelle #
Signe distinctif de Serena Carone, le bestiaire poétique irrigue toute sa production, créant un univers où chaque créature devient le support d’une narration intime. Les dormeuses monumentales — allongées, yeux clos, souvent grenues ou marquetées d’ornements — incarnent une ambivalence entre paix et inquiétude. Les pieuvres de faïence, aux tentacules démultipliés, symbolisent une vitalité trouble, un passage entre liquidité et minéralité.
- Création de figures hybrides : dormeuses, ours, pieuvres, chauves-souris, devenus icônes de l’œuvre.
- Œuvre « Cent chauves-souris » (2012, exposé au Musée de la Chasse et de la Nature, Paris) : installation marquante sur la frontière entre réel et imaginaire animalier.
- L’ours totem : figure centrale, symbole de la solitude et de la puissance anthropomorphique du bestiaire.
À travers ces figures, Carone tisse des récits visuels imbriqués : chaque sculpture participe à une cosmogonie personnelle, enchaînant références à la mythologie, à la littérature, mais aussi à l’inconscient individuel. Nous jugeons que cette faculté à construire un univers peuplé d’énigmes visuelles, souvent discrètes, donne à l’ensemble une cohérence rare sur la scène française.
Les visiteurs de l’exposition « Beau doublé, monsieur le marquis ! » (Paris, 2017-2018) découvrent ainsi un parcours à la fois feutré et onirique, où chaque animal ou dormeuse fonctionne comme maillon d’un récit aux multiples issues.
Résonances et dialogues avec Sophie Calle #
Un tournant s’opère lorsqu’Sophie Calle, artiste conceptuelle majeure née à Paris en 1953, invite Serena Carone à dialoguer lors de l’exposition « Beau doublé, monsieur le marquis ! » au Musée de la Chasse et de la Nature (10 octobre 2017 au 11 février 2018). Ce rapprochement met en jeu une orchestration complexe entre deux univers : celui de la narration photographique, expérientielle et autobiographique de Calle, et le bestiaire sculpté, onirique, de Carone.
À lire Yalanji : Origines et Histoire du Feuilles Farcies à la Vigne
- Dialogue des bestiaires : association symbolique d’animaux totems, de poissons, d’ours, de saumons en cire, qui construisent une dramaturgie commune.
- Pièce centrale « Deuil pour deuil » (2017, faïence émaillée) : Serena Carone y représente Sophie Calle en effigie mortuaire, vêtue d’une robe d’insectes à la manière de Bernard Palissy, entourée de symboles proches du deuil, renforçant l’écho intime entre leurs langages artistiques.
- Événements à résonance nationale : la collaboration entre Calle, auteure de « Histoires vraies », et Carone offre une réflexion sur la place de l’intime, du souvenir et du rituel funéraire dans l’art contemporain.
Nous considérons que ce dialogue, loin de n’être qu’une juxtaposition, relève d’une vraie alchimie narrative : leurs univers se mêlent, fusionnent, et produisent une dramaturgie commune, où chaque spectateur devient acteur d’une mémoire collective et sensible.
Sculpture intime et détournement des récits personnels #
Le recours à l’appropriation de l’intime et à la (ré)invention du familier se retrouve dans nombre de pièces de Serena Carone. L’artiste s’inspire d’éléments autobiographiques, de souvenirs, d’écrits, ou encore de fragments littéraires, pour donner naissance à des œuvres qui dépassent la narration classique.
Ce que nous retenons en particulier, c’est la manière d’insérer ses sculptures, souvent discrètement, dans les espaces d’exposition, sans cartel apparent : le public est invité à la découverte, à l’enquête, à la déambulation sensible.
- Détournement de la mémoire : création de « faux souvenirs » matérialisés, objets hybrides entre précieux et surréaliste.
- Rupture du protocole muséal : absence de légendes visibles, incitant à une attention renouvelée de chaque spectateur.
- Insertion de récits personnels : les sculptures se glissent entre les interstices de l’espace, devenant des balises d’un parcours intime à reconstituer.
Cette démarche, remarquable sur la scène contemporaine, replace l’émotion, mais aussi la réflexion, au centre de l’approche muséale, modifiant profondément notre rapport à l’œuvre d’art.
Rôle et reconnaissance de Serena Carone dans la scène artistique contemporaine #
Serena Carone s’impose aujourd’hui comme une figure singulière et respectée de l’art contemporain français. Sa collaboration marquante avec Sophie Calle, son installation « Cent chauves-souris » au Musée de la Chasse et de la Nature en 2012, ou encore la pièce « Deuil pour deuil » en 2017, témoignent d’une reconnaissance institutionnelle croissante.
À lire L’histoire et la légende du bracelet en poils d’éléphant d’origine africaine
- Expositions majeures : présentations au Musée de la Chasse et de la Nature (Paris), à la Maison Rouge – Fondation Antoine de Galbert (Paris, fermeture en 2018), ou encore à l’international lors de salons spécialisés.
- Collaboration avec des artistes influents : le partenariat avec Sophie Calle marque une nouvelle étape vers le dialogue entre arts visuels contemporains et littérature.
- Ancrage dans les collections publiques : plusieurs œuvres acquises par des institutions telles que les musées d’Arts Décoratifs (Paris) ou le MAMAC de Nice.
Nous estimons que la trajectoire de Serena Carone, forte de son autodidaxie et de la vitalité de son univers sculptural, pointe l’importance stratégique de la recherche personnelle dans la création contemporaine. Sa capacité à susciter l’émerveillement, à transmettre le mystérieux et à inventer de nouveaux mythes est aujourd’hui saluée tant par les professionnels que par le public averti.
L’ensemble de son parcours illustre, enfin, le rôle central de l’artiste plasticien autodidacte dans la redéfinition de la scène artistique française depuis les années 2000.
Plan de l'article
- Serena Carone : Sculptrice des songes et faiseuse de mythes contemporains
- La genèse d’un imaginaire : l’autodidacte et son atelier
- Une matière vivante, façonnée et ritualisée
- Bestiaire et figures énigmatiques : une narration visuelle
- Résonances et dialogues avec Sophie Calle
- Sculpture intime et détournement des récits personnels
- Rôle et reconnaissance de Serena Carone dans la scène artistique contemporaine